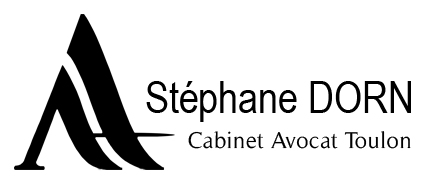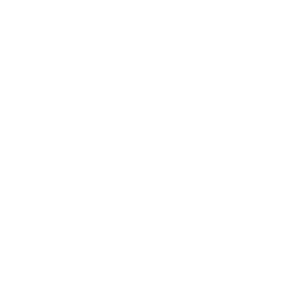Avocat Toulon – Droit de la famille – Jurisprudences

Maître Stéphane DORN, avocat au Barreau de Toulon en droit de la famille depuis plus de 25 années, vous propose un panorama de la jurisprudence récente en droit de la famille, divorce, régime matrimonial, filiation, succession.
1/ Le régime de la communauté et le règlement des dettes
La Cour de cassation rappelle par deux décisions rendues les 2 avril 2025 et 21 mai 2025 les dispositions de l’article 1413 du code civil.
« Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu. »
Dans l’arrêt rendu le 21 mai 2023 ((23-21684), la Cour de cassation rappelle que l’époux qui n’est pas à l’origine de la dette ne peut être condamné personnellement à régler celle-ci, même si un bien commun peut faire l’objet d’une saisie, comme le rappelle la seconde décision rendue le 2 avril 2025 (24-81383), la Cour de cassation confirmant la cour d’appel ayant ordonné la confiscation d’un bien commun.
La Cour de cassation va cependant au bout du raisonnement en rappelant que l’époux qui n’est pas à l’origine de la dette pourra solliciter la récompense qui lui est dûe, et ce conformément aux dispositions des articles 1413 et 1417 du code civil.
2/ L’exercice de l’autorité parentale suite à un divorce ou une séparation
Dans le cadre d’un divorce ou d’une séparation en présence d’enfant mineur, l’autorité parentale est en général exercé en commun par les deux parents.
La Cour de cassation rappelle cependant que le juge aux affaires familiales ne peut déléguer à un des parents son pouvoir de trancher les litiges entre ces derniers, dans le cadre des décisions à prendre.
Elle sanctionne ainsi dans un arrêt du 3 mai 2025 (22-20631), la cour d’appel qui malgré l’exercice conjoint de l’autorité parentale, autorise l’un des parents à prendre seul une décision lorsque l’autre parent ne s’est pas positionné ou s’y est opposé sans raison légitime et n’a pas fait de contre-propositions efficientes.
La Cour de cassation rappelle ainsi que soit l’autorité parentale est exercée exclusivement par l’un des parents, ce qui permet à ce dernier de prendre ce type de décision, soit elle l’est conjointement et nécessairement, le juge doit être saisi, en cas de litige entre les parents relatif à une décision à prendre.
En pratique, le juge est souvent saisi pour décider du lieu d’inscription scolaire de l’enfant ou encore de la nécessité d’un traitement médical.
3/ Successions et partage successoral
En matière de succession, il est possible de solliciter l’attribution préférentielle d’un bien.
La Cour de cassation rappelle cependant dans deux arrêts rendus les 30 avril 2025 (24-15624) et 5 mars 2025 (22-22143), que l’attribution préférentielle est une modalité du partage, ce qui signifie qu’elle ne peut porter que sur des droits compris dans l’indivision à partager, en l’espèce, si l’indivision n’existe qu’en nu-propriété, l’attribution ne peut être sollicitée qu’en propriété et qu’elle ne peut être sollicitée que par des indivisaires unis à leurs coindivisaires par le mariage, le pacs un un héritage commun.
Dans la seconde espèce, la Cour de cassation rappelle que l’attribution préférentielle ne peut être sollicitée par des indivisaires qui détiennent leurs droits suite à une cession, en l’espèce, il s’agissait d’un des enfants et de son épouse.
4/ Succession et validité d’un testament
La Cour de cassation rappelle par un arrêt en date du 26 mars 2025 (23-14430), la validité de la procédure en vérification d’écriture en matière de testament olographe.
En l’espèce, elle rappelle que la vérification d’écriture doit impérativement s’effectuer à partir de l’original de l’acte contesté et que la signature du testateur doit nécessairement être apposée à la suite du contenu de l’acte.
En l’espèce, la cour d’appel avait admis la vérification sur la base d’une copie, l’estimant lisible et exploitable et avait surtout validé la présence d’une disposition portée en dessous de la signature du défunt !
Il s’agit d’une position classique adoptée par la Cour de cassation depuis de nombreuses années, celle-ci exigeant l’original du testament, tout comme l’exigence d’une signature à la suite des dispositions, conformément aux dispositions de l’article 970 du code civil qui dispose :
« Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »
En effet, ces dispositions sont précises et exigent que le défunt approuve le contenu de l’acte en apposant à la suite, sa signature.
5/ Succession et prescription de l’action en recel successoral
La Cour de cassation précise que l’action en recel successoral présente le caractère d’une action personnelle et est soumise à la prescription quinquennale dans un arrêt rendu le 3 mars 2025 (23-10360).
Cette décision permet de clarifier la situation en la matière, car aucun texte ne précisait le délai applicable.
Le recel successoral est défini par les dispositions de l’article 778 du code civil qui dispose :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Le point de départ de ce délai de prescription est cependant important, puisqu’il ne s’agit pas du décès mais de la date à laquelle le demandeur à l’action a connu ou aurait dû connaître les faits, lui permettant d’exercer l’action.
6/ Divorce et prestation compensatoire
La Cour de cassation précise par une décision rendue le 30 avril 2025 (23-14618), que les juges du fond doivent pour apprécier l’existence d’une disparité des conditions de vie entre les deux époux, rechercher si la situation de concubinage du débiteur n’entraînait pas cette disparité.
En la matière, il convient de rappeler les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, relatives à la prestation compensatoire
« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »
« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– leur qualification et leur situation professionnelles ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits existants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »
Cette décision demandera à être confirmée en l’état des dispositions applicables, afin de déterminer si l’existence d’un concubinage de l’époux débiteur au moment du divorce est considéré comme une source de ressources pour ce dernier.
En toute hypothèse, l’époux créancier devra apporter la preuve de l’existence du concubinage de son conjoint conformément aux dispoitions de l’article 515-8 du code civil :
« Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »
Par Maître Stéphane Dorn, Avocat en Droit de la famille